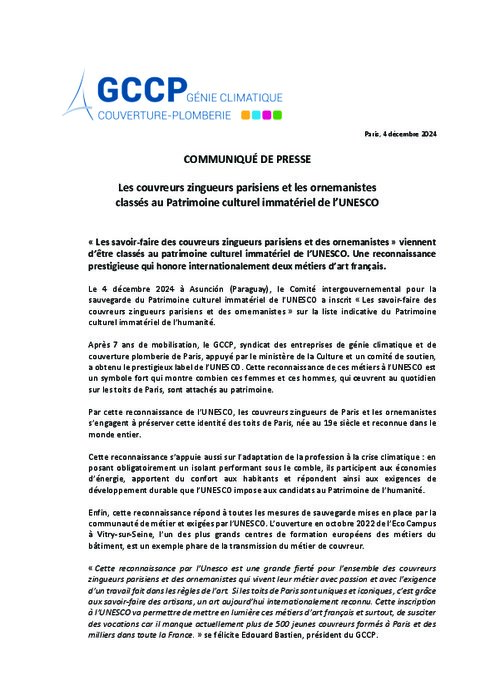Tirant leur nom du zinc, ce métal gris qui recouvre près de 80% des toitures parisiennes, les couvreurs-zingueurs (pose et restauration) ont, avec les ornemanistes (décoration), contribué aussi à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame.
"Cette candidature, je l'ai toujours vue comme la valorisation d'un patrimoine qui se projette dans l'avenir" se réjouit Delphine Bürkli, maire du 9e arrondissement de Paris, "émue et fière" de voir l'aboutissement de cette candidature qu'elle a initiée dix ans plus tôt, en 2014.
"Paris sans ses toits, c'est Paris sans sa tour Eiffel", résume l'élue parisienne.
La candidature, déposée en 2017, a finalement été sélectionnée par le ministère de la Culture fin 2022 et présentée à l'Unesco comme choix de la France en mars 2023.
Elle compte parmi les 67 dossiers étudiés cette semaine par le Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, réuni depuis lundi à Asuncion, au Paraguay, qui a également classé quelques heures plus tôt la culture foraine en France et en Belgique.
"Ce que l'on voulait d'abord, c'était faire connaître le geste, faire connaître ce métier qui se transmet de génération en génération", explique Mériadec Aulanier, délégué général du Syndicat des entreprises de génie climatique et couverture plomberie, qui déplore le "déficit d'image" dont souffre la profession.
Avec cette inscription, il espère attirer de jeunes talents alors que la profession, qui compte entre 5.000 et 6.000 couvreurs aujourd'hui à Paris, manque de main-d'oeuvre depuis des années.
"Il y a une fierté pour eux de se dire que leur métier va être reconnu internationalement", se réjouit Gilles Mermet, photographe ambassadeur des toits de Paris et coordinateur de la candidature à l'Unesco.
Nés au XIXe siècle avec la généralisation des toits en zinc et en ardoise par le préfet Haussmann, ces savoir-faire sont aujourd'hui aux premières loges de l'adaptation au changement climatique, qui surchauffe les toits parisiens l'été.